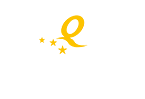Questions-réponses de la session "Demain"

Eric Sutherland
Economiste de la santé senior, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Vous avez dit qu’on ne pouvait pas demander à l’intelligence artificielle (IA) de rendre des comptes, qu’il ne s’agissait que de mathématiques. Mais que se passerait-il si l’IA générale développait une conscience ?
Le terme « intelligence artificielle générale » (IAG) désigne des systèmes qui ne sont pas conçus pour exécuter des tâches spécifiques, mais qui sont, au contraire, capables de comprendre et d’accomplir une multitude de tâches. L’IAG n’a pas de conscience et, à ce jour, rien ne laisse présager que les systèmes d’intelligence artificielle seront capables, à l’avenir, d’en développer une. En revanche, l’obligation de rendre des comptes incombe aux décisionnaires. Ainsi, lorsqu’il s’agit des soins de santé, quiconque a le droit de prendre une décision a, par là même, l’obligation de rendre des comptes. Comme les décisions de santé sont généralement prises par des professionnel·les de santé formé·es à cette fin, ce sont elles et eux qui en seront tenus pour responsables. Par exemple, il existe actuellement des systèmes d’aide à la décision déployés en milieu clinique (notamment pour évaluer un ECG ou pour prescrire des médicaments) dans le but d’émettre des recommandations pour la ou le médecin, mais c’est bien elle ou lui qui prend la décision et doit en assumer la responsabilité.
Est-ce que l’IA remplacera les médecins ?
À ce jour, l’IA ne peut pas remplacer les médecins. Toutefois, en fonction de la manière dont elle évoluera, il n’est pas exclu de voir un jour apparaître des robots médecins. Cela dépendra surtout de nous – des métiers que nos sociétés décideront d’automatiser et du point jusqu’auquel nous irons dans cette voie. Il vaut mieux envisager les solutions d’IA comme un moyen d’augmenter les capacités humaines.
Diriez-vous qu’« intelligence artificielle » n’est pas le terme adapté et que nous devrions plutôt parler d’« algorithmes » ?
Bien que les deux ne soient pas vraiment interchangeables, le terme « algorithmes » peut remplacer celui d’« intelligence artificielle » lorsqu’on parle de systèmes d’aide à la décision en milieu clinique. On peut, sans problème, faire l’analogie entre algorithmes et IA, si l’on parle de l’IA développée depuis les années 1940. En revanche, les dernières avancées, qui comprennent l’apparition de l’IA générative, sont trop complexes pour parler simplement d’« algorithmes ». Pour ma part, je préfère utiliser le terme « intelligence augmentée », car il met l’accent sur la capacité de l’outil à aider les humains à prendre des décisions.
Il ne fait nul doute que l’IA est un outil puissant, mais comment garantir que les données utilisées sont exactes et réelles ?
La qualité des données compte parmi les enjeux principaux du développement d’une IA puissante : sans données de qualité, pas d’IA performante. Par ailleurs, une IA aux performances insuffisantes ne serait pas (ou ne devrait pas être) approuvée pour une utilisation clinique. Par conséquent, la qualité des données est bien plus problématique pour le développement des algorithmes que pour leur déploiement. C’est pourquoi il est essentiel d’inclure un programme de gouvernance des données – avec une approche de l’IA définie – dans toute stratégie globale d’intelligence artificielle au service de la santé.
Les humains restent responsables de leurs actes, mais à quel point pouvons-nous faire confiance aux évaluations rendues par l’IA ? Nous ne pouvons pas réévaluer les données nous-mêmes – quel est le niveau de contrôle qualité sur l’IA ?
Cette question concerne principalement l’IA comme outil d’aide à la décision. La qualité de tout algorithme destiné à une utilisation clinique fait l’objet d’une évaluation qui vise à déterminer, sur la base de différents paramètres (sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives et négatives), si l’algorithme considéré est suffisamment exact pour être déployé en milieu clinique. Lorsqu’un·e médecin se sert d’un algorithme comme outil d’aide à la décision, elle ou il doit se demander si les résultats produits par l’algorithme corroborent ses connaissances et décider ensuite d’accepter ou de rejeter la décision/suggestion formulée par l’algorithme. Les deux instances qui sont clés pour créer de la confiance et à qui incombe la responsabilité dans le cadre de ce processus sont 1) les autorités réglementaires comme la FDA ou l’EMA, qui approuvent l’utilisation de l’outil en milieu clinique et 2) les personnels de santé, qui prennent les décisions en faisant appel à leur expertise médicale et à leur jugement.
Est-il possible de valider une IA en se basant sur les exigences de la norme CFR 21 et/ou des GxP ?
Valider un algorithme signifie démontrer son exactitude dans un cadre précis pour une tâche clinique spécifique. Les réglementations varient selon les pays en ce qui concerne l’autorisation des algorithmes et le niveau de preuve requis pour l’obtenir. Ce sujet fait constamment l’objet de discussions. On se demande comment et quand les solutions d’IA seront validées cliniquement et comment cette validation sera gérée à mesure de l’amélioration continue de ces solutions.
Les médecins risquent fortement, à l’avenir, de toujours se reposer sur les diagnostics suggérés par l’IA. Comment pouvons-nous limiter ce risque ?
Si l’on en croit la littérature actuelle, les résultats concernant l’excès de confiance dans l’IA (et dans d’autres systèmes d’aide à la décision) sont mitigés, la tendance à une confiance excessive étant globalement basse. De manière générale, pour éviter cet écueil, il faudrait que les médecins connaissent mieux les forces et les faiblesses des systèmes d’aide à la décision pour en dépendre moins. Il est donc essentiel de les former à l’intégration responsable de l’IA dans leurs processus décisionnels, notamment par des recommandations les forçant à se remettre en question. Les médecins risquent d’avoir moins l’occasion de développer leurs compétences diagnostiques du fait de la place de plus en plus importante laissée à l’IA. Il restera crucial que les personnels de santé offrent un visage humain aux personnes soignées et disposent des connaissances et compétences nécessaires pour leur apporter des soins d’excellente qualité, que des outils comme l’IA renforceront de plus en plus.
Vu que l’IA présente de possibles avantages et que nous, en tant qu’êtres humains, avons du mal à renforcer la collaboration, ne pourrions-nous pas utiliser l’IA pour améliorer la collaboration et la cohésion ?
Ce n’est pas parce que nous utilisons l’IA dans un but précis que nous ne pouvons pas l’utiliser à d’autres fins. Cela étant dit, l’IA est un outil employé par les humains. Si les êtres humains ne souhaitent pas collaborer, l’IA ne peut pas les forcer à le faire. L’IA employée comme outil peut cependant faciliter la collaboration, par exemple en identifiant des sujets d’intérêt commun ou en surmontant des obstacles à la communication.
Concernant les personnes donneuses de sang/d’organes, comment pouvons-nous assurer la sécurité et l’anonymat des données ? Qui les possède ? Qui peut les exploiter ? Les patient·es, les entreprises, les États ?
La gouvernance des données est cruciale et les niveaux d’anonymat et de sécurité nécessaires varient en fonction de la nature des données. La propriété des données ne fait l’objet d’aucun consensus réglementaire/juridique. En principe, chaque individu devrait pouvoir exercer son droit d’opposition ainsi que son droit à l’oubli. Tout le monde peut profiter du partage de données. En outre, plus les données sont partagées, plus les sociétés peuvent en tirer parti. On voit ainsi apparaître un nombre croissant de technologies d’amélioration de la protection de la vie privée, qui permettent de renforcer la sécurité et l’anonymat des données tout en optimisant leur exploitation.
Cela semble quelque peu utopique : des données circulant librement à travers les frontières entre des personnes partageant les mêmes valeurs et recherchant des bénéfices communs. C’est super, mais que faire lorsque les personnes avec lesquelles nous partageons ces données ne sont pas loyales ?
Le mésusage des données par des personnes malveillantes est un risque sérieux. Cependant, il y existe un juste milieu entre le verrouillage des données et leur mise à disposition en accès illimité. Il est ainsi possible, du point de vue technique, de mettre des données à disposition sans communiquer les points de données individuels. Nous préconisons donc de rendre les données disponibles et d’utiliser les technologies adéquates pour les surveiller et en prévenir le mésusage. Pour gouverner l’écosystème des données, il conviendrait de filtrer les personnes déloyales et d’établir des pénalités claires en cas de mésusage.
Les personnes prises en charge doivent consentir au recueil de leurs données. Comment faire en sorte qu’elles aient suffisamment confiance en l’IA pour partager les données nécessaires à l’établissement d’un système de santé préventif ?
Les règles qui régissent l’IA sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux données. La question de l’obtention du consentement à l’utilisation de données à caractère personnel – en particulier dans le cadre du développement de solutions d’IA, mais aussi plus généralement dans le secteur de la santé numérique – représente aujourd’hui un casse-tête, sachant que les approches traditionnelles donnent des résultats mitigés. Dans ce domaine, la collaboration à l’échelle de l’Europe permettra de libérer le potentiel salvateur des données à caractère personnel pour les individus et leurs communautés, tout en protégeant leur vie privée. Ainsi, alors que nous délaissons les systèmes de santé traditionnels, centrés sur les institutions, pour privilégier des systèmes de santé véritablement centrés sur les personnes, il va devenir nécessaire d’y intégrer une architecture du consentement afin d’obtenir et de diffuser largement le consentement des personnes. De la même manière, ces modèles reposant sur le consentement devront identifier les cas dans lesquels la nécessité d’utiliser des données dans l’intérêt public primera sur le consentement individuel et mettre en place des garde-fous pour protéger les données à caractère personnel dans ces cas précis. Pour renforcer la confiance du public, nous devons coconcevoir, avec lui, une architecture du consentement adaptée à un système centré sur les personnes. Une fois cela en place, il sera ensuite indispensable de communiquer avec le grand public pour garantir sa liberté de choix, tout en assurant la sécurité et l’égalité de toutes et tous.


Fiona Adshead
Présidente de la Sustainability Healthcare Coalition
Kirsty Reid
Directrice de la politique scientifique, Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA)
Le transport mondial a un impact considérable sur l’environnement. Que peut-on faire de plus pour créer un écosystème local destiné aux produits pharmaceutiques tout en continuant à promouvoir l’accessibilité ?
De nombreuses initiatives sont en cours pour diminuer les impacts du transport des matières premières et des médicaments. On parle ici d’émissions de scope 3, qui sont les plus inquiétantes. Les entreprises s’engagent à réduire leurs émissions et œuvrent en ce sens avec leurs fournisseurs. Des études de cas spécifiques sont présentées dans le document suivant : https://www.efpia.eu/media/sydk5acr/white-paper-on-climate-change.pdf.
Quelle est la responsabilité de l’industrie vis-à-vis des médicaments et substances excrétés par les patient·es dans l’environnement, et quelles mesures prend-elle en conséquence ?
Ces dernières années, de nombreuses initiatives menées dans le cadre de l’Eco-Pharmaco-Stewardship – programme créé par la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA), par l’Association européenne des spécialités pharmaceutiques grand public (AESGP) et par Medicines for Europe – ont aidé à approfondir la compréhension scientifique, à trouver de nouveaux moyens de détection des traces de substances pharmaceutiques dans l’environnement, à comprendre les répercussions de leur présence, à classer par ordre de priorité les substances actives présentant un risque pour l’environnement, mais aussi à réduire davantage les rejets provenant des usines. En tant qu’industrie, nous nous efforçons d’améliorer continuellement nos processus de production afin de fournir des traitements vitaux sans pour autant nuire à l’environnement. Pour une vue détaillée des mesures prises, voir le document suivant : https://www.efpia.eu/media/636524/efpia-eps-brochure_care-for-people-our-environment.pdf.
Comment mettre au point des processus de soins de santé plus respectueux de l’environnement sans pour autant nuire à la santé des patient·es ?
Les organisations de soins de santé et les personnels cliniques devraient toujours donner la priorité aux besoins des personnes qu’ils prennent en charge et n’adopter des solutions écologiques que si elles sont cliniquement appropriées.
L’écologisation des systèmes de santé peut s’accompagner de multiples bénéfices mutuels : une offre de soins plus efficace et plus efficiente grâce à la réduction des coûts énergétiques, un gain d’efficacité et la promotion d’une intervention précoce, mais aussi de la prévention.
Pour retirer ces bénéfices, nous devons tenir compte des facteurs environnementaux dans la prise de décisions relatives aux soins de santé et considérer qu’en étant « durables dès la conception », nous pouvons améliorer les résultats cliniques, mais aussi réduire les coûts et l’impact environnemental.
Il sera indispensable de disposer de méthodes de mesure standard et harmonisées pour atteindre ce but. Grâce aux travaux d’évaluation de l’impact environnemental tout au long du parcours de soins que nous avons menés au sein de la Sustainable Healthcare Coalition, nous savons combien il est important d’adopter une approche systémique pour mesurer cet impact (https://shcoalition.org/sustainable-care-pathways/) et combien il est crucial de collaborer pour mettre au point de nouvelles méthodes d’évaluation, comme celles appliquées aux essais cliniques (https://shcoalition.org/clinical-trials/).
L’écoproduction des substances actives coûte généralement plus cher, pour ce qui est des équipements notamment. Est-ce que cela ne se répercutera pas sur le prix des médicaments ?
Différents facteurs influent sur le prix des médicaments, notamment l’étendue de la R&D, le coût des composants et le type de traitement. Les inquiétudes au sujet des coûts ne devraient pas freiner les investissements dans des modes de production écoresponsables ni leur développement.

Mark Skylar-Scott
Maître de conférences en bio-ingénierie, université Stanford
Pour que cela devienne une réalité sans trop tarder, quelles sont les premières étapes que devraient suivre les responsables politiques à l’échelle européenne ?
Augmenter le financement, par les gouvernements, de la recherche scientifique fondamentale et appliquée demeure la meilleure façon de soutenir la réflexion audacieuse et à long terme nécessaire pour faire progresser les technologies comme la biofabrication d’organes. À la lumière des avancées réalisées dans le domaine de la bioimpression 3D et des cellules souches, les États-Unis et la Chine ont largement investi dans la bioimpression d’organes. Sans pays phare dans ce domaine, l’UE reste encore en retrait pour le moment. Outre le financement, les responsables politiques devraient promouvoir une communication approfondie et régulière entre scientifiques, ingénieur·es, autorités réglementaires, parlementaires et groupes de défense des patient·es afin de veiller à ce que les technologies de biofabrication d’organes soient développées avec une attention particulière portée à l’égalité d’accès, aux préoccupations éthiques, à la sécurité et au bien-être des patient·es.
Les technologies de bio-impression 3D dans un support d’hydrogel semblent prometteuses. Pourquoi est-ce que nos pays ne font pas l’effort de financer en priorité la recherche dans ce domaine ?
La bio-impression 3D dans un support d’hydrogel est sans doute l’une des avancées les plus passionnantes de ces dix dernières années. Elle nous permet d’imprimer des tissus mous et vivants sur des supports 3D complexes. La bonne nouvelle est que l’UE compte déjà plusieurs scientifiques leaders dans le domaine de la bioimpression 3D dans un support d’hydrogel et dans d’autres types de bioimpression 3D. Cependant, le manque de financement demeure le frein principal aux avancées technologiques en sciences fondamentales et appliquées. Les contraintes financières sont particulièrement fortes quand il s’agit de fabriquer des organes de grande taille. En effet, les organes entiers nécessitent beaucoup de cellules et de biomatériaux. Or, ces ingrédients coûtent cher !
Merci pour votre présentation. Pensez-vous que cela s’applique aux organes autologues uniquement ou également aux organes allogéniques, dans le cas où la fabrication des organes autologues demanderait trop de temps ou ne fonctionnerait pas ?
Les cellules souches pluripotentes induites utilisées dans des essais cliniques sont, pour la plupart, des cellules allogéniques mises en banque (obtenues par don), et ce, dans le but d’alléger la charge réglementaire, administrative et économique associée aux thérapies autologues. Dans le cadre de notre programme de fabrication d’organes, la différence entre organes autologues et organes allogéniques n’a que très peu d’impact sur les aspects scientifiques ou techniques, et nous avons opté pour une lignée cellulaire mise en banque pour réaliser nos premières démonstrations. Cependant, comme les scientifiques, les personnels cliniques et les autorités réglementaires gagnent en expérience en matière de dérivation, de caractérisation, de régulation et d’administration de cellules souches, je crois que les bénéfices d’une transplantation sans risque de rejet et ne nécessitant pas la prise d’immunosuppresseurs à vie aboutiront, à long terme, à la généralisation des approches autologues.

François-Xavier Lery
Chef de la Section Suivi pharmaceutique et protection des consommateurs, EDQM, Conseil de l’Europe
On a beaucoup entendu parler de collaboration avec les parties intéressées et les patient·es. Comment faire entendre la voix des patient·es dans le cadre du processus décisionnel ?
L’EDQM implique ses parties intéressées, dont les patient·es, en menant des enquêtes publiques ciblées au sujet des projets de normes qu’elle élabore (p. ex. recommandations/résolutions destinées aux gouvernements ou orientations destinées aux personnels/autorités de santé) avant de faire adopter ces normes aux États membres par le biais des comités intergouvernementaux, puis par le Comité des Ministres, le cas échéant.

Vanja Nikolac-Markić
Cheffe de la Division Substances d’origine humaine (SoHO), EDQM, Conseil de l’Europe
Quelle est la cause principale des pénuries d’organes en Europe ? Que pouvons-nous faire pour améliorer la situation ?
La demande de greffes d’organes ne cesse d’augmenter dans le monde entier. De plus en plus de personnes sont, en effet, éligibles à ces traitements susceptibles de sauver la vie, qui se soldent de plus en plus par une issue heureuse. Cependant, la demande dépasse largement le nombre d’organes obtenus par don ou disponibles pour des transplantations, d’où la pénurie d’organes.
Pour pouvoir prélever les organes d’une personne décédée, il faut tout d’abord vérifier si elle a exprimé la volonté de donner ses organes après sa mort, puis s’assurer que le système de santé est en mesure de prendre en charge ce processus dans le respect des normes professionnelles les plus strictes. Il est donc essentiel de sensibiliser le grand public au don d’organes et de faire comprendre qu’il s’agit d’une responsabilité envers la société et d’une décision qui mérite d’être discutée et prise de son vivant. Chaque année, la Journée européenne du don d’organes, de tissus et de cellules
(EDD) est organisée par un pays hôte, avec le soutien de l’EDQM. Le pays qui accueille l’édition de l’année organise des manifestations afin de sensibiliser le grand public aux besoins de dons d’organes, de tissus et de cellules, de promouvoir le principe du don volontaire non rémunéré et de rendre hommage aux personnes donneuses comme aux personnels de santé. En savoir plus sur l’EDD.
Il est également nécessaire d’adapter l’organisation et les capacités techniques des systèmes de santé aux besoins spécifiques du processus de don, qui se déroule dans un contexte des plus délicats, celui des soins de fin de vie. Toutes les questions éthiques susceptibles d’être soulevées (concernant les soins de fin de vie et le processus de don) devraient être résolues en toute transparence afin de ne pas ternir la confiance du public.
Quelles mesures concrètes l’EDQM pourrait-elle prendre pour aider au développement de ces organes artificiels ? En effet, on aimerait mieux faire autrement que de compter sur les victimes d’accidents de voiture…
Bien que les résultats soient encourageants, la R&D en matière d’organes artificiels en est encore aux prémices. Les problèmes liés aux organes artificiels sont complètement différents de ceux associés à la transplantation d’organes humains. Par conséquent, pour le moment au moins, ce domaine ne figure pas au programme de travail de l’EDQM.

Alexandre Méjat
Directeur adjoint & Responsable du pôle Réseaux scientifiques internationaux, AFM Téléthon
Les cellules CAR-T sont-elles déjà utilisées dans le traitement contre le cancer ? Comment rendre une thérapie génique si onéreuse accessible à un grand nombre de personnes ?
Oui, la technologie des cellules CAR-T est déjà utilisée pour soigner des lymphomes et certaines leucémies aiguës de l’enfant, mais elle nécessite de prélever les lymphocytes de la personne traitée, de les congeler et de les envoyer aux États-Unis ou en Europe (une unité de production sera prochainement opérationnelle en France). Pour réduire le coût du traitement et le rendre plus accessible, il faudrait que la modification des lymphocytes soit effectuée directement à l’hôpital, et donc que plus d’hôpitaux aient les moyens de produire ces cellules sur site.
La thérapie génique offre des perspectives très prometteuses. Quels sont les trois défis principaux qu’elle pose et comment les relever ?
Pour rendre la thérapie génique accessible au plus grand nombre, il faut :
- mieux comprendre la réponse immunitaire induite par ces traitements, afin d’en maîtriser les conséquences ;
- accroître la capacité de production, pour diminuer indirectement le coût de ces thérapies innovantes ;
- mettre en place des programmes de diagnostic génétique, notamment le dépistage des nouveau-nés, afin de réduire les retards de diagnostic et de garantir un accès au traitement le plus tôt possible.
La thérapie génique (Zolgensma) peut-elle aider à traiter l’amyotrophie spinale (SMA) de type 2 chez l’enfant de 2-3 ans ?
La thérapie génique indiquée pour le traitement de la SMA est plus efficace si elle est administrée tôt. Elle est d’une efficacité maximale avant l’âge de 6 mois, bien que certains pays en autorisent les injections jusqu’à l’âge de 2 ans. Plus tard, les effets risquent d’être très limités.
Comment résoudre le problème des impuretés dans les thérapies géniques ?
Pour éliminer les impuretés présentes dans les préparations de thérapie génique, il faut non seulement éliminer les éléments qui ne sont pas des vecteurs de thérapie génique, mais aussi séparer les capsides vides (inactives) des capsides pleines (actives). Plusieurs méthodes de séparation par gradient ou par filtration peuvent être utilisées pour purifier les préparations. Toutefois, les recherches visant à augmenter les capacités de production des vecteurs de thérapie génique tout en accroissant la pureté de ces derniers battent toujours leur plein.
Peut-on espérer traiter la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot de la même manière que la SMA ?
Ces dernières années, des approches de thérapie génique ont été développées pour traiter les formes démyélinisante (CMT4J), intermédiaire (CMTX1) et axonale (CMT2D) de la maladie de Charcot-Marie-Tooth : elles permettent d’apporter un gène thérapeutique aux cellules de Schwann et ainsi de réduire les atteintes des nerfs périphériques.
De la même manière, pour la SLA, l’idée est de produire un vecteur viral qui permettra d’apporter un gène SOD1 ou FUS thérapeutique aux cellules malades, puis de l’injecter dans le cerveau et la moelle épinière pour qu’il pénètre dans les motoneurones.
Quelle proportion de nouveau-nés devrait être soumise aux tests de dépistage de la SMA de type 1 ?
D’après les tout derniers programmes de dépistage néonatal, la prévalence de la SMA est d’environ 1/15 000 (entre 1/7000 et 1/30 000) et la SMA de type 1 représente environ 50 % des cas. Les programmes pilotes permettent généralement de dépister quelque 200 000 bébés avant d’être étendus aux programmes nationaux généralisés.